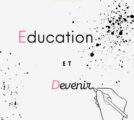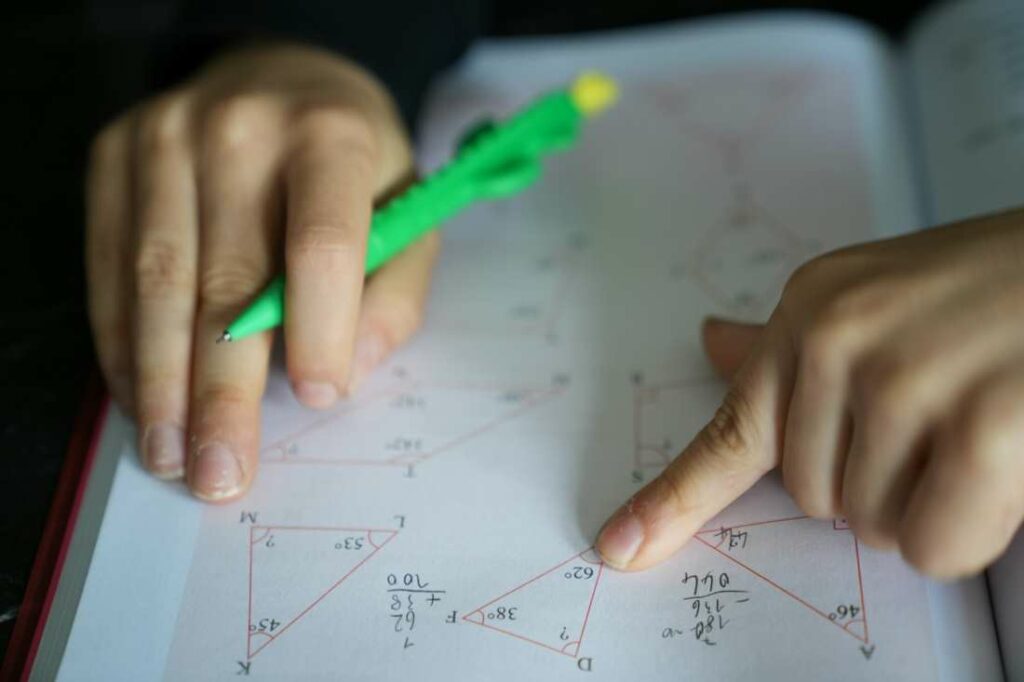L’éducation musicale en classe de 3ème représente une étape charnière dans le parcours musical au collège. C’est en effet la dernière ligne droite du cycle 4, qui vient consolider les acquis des années précédentes tout en préparant les élèves au brevet des collèges.
Le programme de 3ème en éducation musicale s’articule autour de compétences variées : analyse acoustique critique, le chant, l’exploration de la création sonore et la découverte de l’histoire des arts.
Selon une étude menée par le Ministère de l’Éducation Nationale en 2022, 78% des élèves considèrent que les cours de musique favorisent leur épanouissement personnel et leur ouverture culturelle.
Dans cet article, nous allons explorer en détail les différentes composantes du programme, les objectifs pédagogiques, les modalités d’évaluation ainsi que les liens avec les autres disciplines. Que vous soyez un élève curieux de connaître ce qui vous attend ou un parent souhaitant accompagner votre enfant, ce guide complet vous éclairera sur tous les aspects de l’éducation musicale en 3ème.
Les objectifs du programme d’éducation musicale en 3ème 🎶
Le programme d’éducation musicale en classe de 3ème s’inscrit dans la continuité des apprentissages du cycle 4, tout en visant à approfondir certaines compétences spécifiques.

Comme pour d’autres matières artistiques, comme le programme d’arts plastiques de 3ème, l’objectif principal est ici de développer la sensibilité artistique des élèves, leur capacité d’écoute critique et leur connaissance du patrimoine musical mondial.
Ces compétences ne sont pas seulement précieuses pour l’épreuve d’histoire des arts du brevet, mais constituent également un bagage culturel qui accompagnera les élèves tout au long de leur vie.
Les compétences travaillées se répartissent en quatre grands domaines :
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de composition : chanter, jouer d’un instrument, composer, arranger, improviser,
- Écouter, comparer, construire une socle musical commun : analyser des œuvres, développer un esprit critique, identifier des caractéristiques sonores et harmoniques,
- Explorer, imaginer, créer et produire : expérimenter avec la voix et différents outils sonores, manipuler des éléments musicaux,
- Échanger, partager, argumenter et débattre : exprimer ses goûts, porter un regard critique, participer à des débats argumentés.
Ces compétences sont travaillées de manière progressive et spiralaire tout au long de cette période, avec une complexité croissante par rapport aux années précédentes au collège.
Le programme vise également à préparer les élèves à l’épreuve orale du brevet qui peut porter sur un projet musical réalisé en cours. Cette préparation inclut non seulement la maîtrise technique des œuvres interprétées, mais aussi la capacité à contextualiser et à analyser ces œuvres, compétences essentielles pour réussir cette épreuve.
En fin de 3ème, au fil de l’enseignement, les élèves doivent être capables de mobiliser leurs connaissances musicales pour comprendre et apprécier des œuvres de styles et d’époques variés, tout en développant leur propre sensibilité artistique.
Ce socle de compétences constitue une base solide pour ceux qui souhaiteraient poursuivre des études musicales au lycée.
La pratique vocale et instrumentale : piliers de l’éducation musicale 🎤
La pratique active constitue le cœur du programme d’éducation musicale au collège.

Elle se décline principalement à travers deux axes fondamentaux : la pratique vocale (ou chant) et la pratique instrumentale. Ces activités occupent généralement plus de la moitié du temps de cours hebdomadaire, soit environ 30 minutes sur l’heure de cours.
Le chant en 3ème
Le chant choral reste l’activité centrale en éducation musicale. En 3ème, les élèves abordent un répertoire plus exigeant, incluant :
- Des chansons françaises contemporaines (variété, rap, chanson à texte),
- Des pièces polyphoniques à plusieurs voix (2 ou 3 voix),
- Des extraits d’œuvres issues de différentes traditions sonores mondiales,
- Des morceaux en langues étrangères (anglais, espagnol, italien…),
- Des extraits adaptés de comédies musicales ou d’opéras.
La technique vocale est travaillée de manière plus approfondie qu’en 4ème, avec une attention particulière portée à la justesse, la précision rythmique, l’expression et l’interprétation. Les élèves apprennent à contrôler leur respiration, à placer leur voix et à nuancer leur interprétation en fonction du style musical abordé.
D’après une enquête menée par l’Association des Professeurs d’Éducation Musicale (APEMU) en 2021, 82% des enseignants considèrent chanter est l’activité qui permet le mieux de développer l’esprit de groupe et la confiance en soi chez les élèves de 3ème.
La pratique instrumentale
Parallèlement au chant, l’exercice instrumental s’intensifie en 3ème. Les élèves sont amenés à manipuler divers instruments :
- Percussions (djembés, congas, xylophones, métallophones),
- Instruments harmoniques (guitares, claviers, ukulélés),
- Instruments à vent (flûtes à bec, petites percussions),
- Technologies numériques (applications musicales sur tablettes, logiciels de MAO).
Les arrangements sont généralement plus élaborés qu’en 4ème, avec l’introduction de parties instrumentales complémentaires aux voix chantées. Les élèves peuvent être répartis en plusieurs groupes, chacun ayant une partie spécifique à jouer, favorisant ainsi l’écoute mutuelle et la coordination.
Jouer de plusieurs instruments en 3ème vise également à développer l’autonomie des élèves. Ils sont encouragés à proposer leurs propres arrangements, à improviser dans un cadre donné et à prendre des initiatives dans l’interprétation. Certains projets peuvent même impliquer la composition de courtes pièces originales, permettant aux élèves d’explorer leur créativité.
Les compétences développées à travers ces activités musicales actives sont multiples : coordination, concentration, mémorisation, écoute de l’autre, expression personnelle. Elles constituent un excellent moyen de préparer les élèves à l’épreuve orale du brevet, en leur donnant confiance en leurs capacités à s’exprimer en public et à défendre un projet créatif.
En fin d’année, ces exercices aboutissent souvent à une production finale, comme un concert ou un spectacle interdisciplinaire, permettant aux élèves de valoriser leur travail et de vivre une expérience artistique complète, de la préparation à la représentation publique.
Une matière qui peut donc être facilement reliée au programme d’histoire des arts en classe de 3ème !
L’écoute musicale et la culture artistique au programme de 3ème 🎷
L’analyse musicale constitue un pilier essentiel du programme d’éducation musicale en 3ème, permettant aux élèves de développer leur culture artistique et leur esprit critique.

Cette dimension du programme s’articule autour de séquences d’écoute structurées et progressives, visant à former l’oreille des adolescents tout en enrichissant leurs connaissances culturelles.
En 3ème, les activités d’analyse se caractérisent par une approche plus analytique et contextualisée qu’en 4ème. Les élèves sont amenés à découvrir des œuvres variées issues de différentes périodes historiques, aires géographiques et styles musicaux. Le programme recommande d’explorer notamment les musiques :
- Savantes occidentales, de la Renaissance à la musique contemporaine,
- Actuelles (rock, jazz, rap, musiques électroniques…),
- Traditionnelles de différentes origines,
- Musiques de film et les musiques fonctionnelles,
- Les liens entre musique et autres disciplines créatives (danse, théâtre, cinéma, arts visuels).
Lors des séances d’analyse, les élèves apprennent à identifier et à décrire précisément les éléments musicaux entendus : timbres, structures, dynamiques, textures sonores, modes de jeu. Ils développent progressivement un vocabulaire technique approprié pour verbaliser leurs perceptions et leurs analyses.
Le programme de 3ème met particulièrement l’accent sur quatre grandes thématiques qui servent de fil conducteur aux séquences d’écoute :
- Musique et identité : comment la musique exprime-t-elle l’appartenance à un groupe, une culture, une époque ?
- Musique et technologies : comment les innovations techniques ont-elles transformé la production et la diffusion de musique ?
- Musique et pouvoir : quelles relations la musique entretient-elle avec les pouvoirs politiques, économiques ou religieux ?
- Musique et mondialisation : comment les échanges culturels façonnent-ils les techniques sonores contemporaines ?
Ces thématiques permettent d’aborder les œuvres dans une perspective interdisciplinaire, en faisant des liens avec l’histoire, la géographie, les lettres ou les sciences. Par exemple, l’étude du jazz peut être mise en relation avec l’histoire des États-Unis et des mouvements pour les droits civiques.
En complément des activités d’écoute en cours, les professeurs organisent parfois des sorties culturelles (concerts, opéras, musées) ou font intervenir des musiciens professionnels. Ces expériences directes avec le monde des arts sonores enrichissent considérablement le socle artistique des élèves et donnent du sens aux apprentissages théoriques.
L’évaluation de cette dimension du programme repose généralement sur la capacité des élèves à situer une œuvre dans son contexte, à en identifier les caractéristiques principales et à exprimer un jugement esthétique argumenté. Ces compétences sont particulièrement utiles pour l’épreuve d’histoire des arts du brevet, où les connaissances acquises en éducation musicale peuvent être mobilisées.
Ne négligez pas les autres matières moins artistiques, comme le programme de sport de 3ème !
Les projets musicaux et l’évaluation en éducation musicale 🎵
Les projets musicaux constituent l’un des aspects les plus stimulants du programme d’éducation musicale en 3ème.

Ils permettent aux élèves de mettre en œuvre l’ensemble des compétences acquises dans un cadre concret et motivant. Ces projets prennent diverses formes et s’inscrivent dans une démarche pédagogique active où l’élève devient acteur de ses apprentissages.
Les types de projets musicaux en 3ème
En 3ème, les projets musicaux se caractérisent par leur ambition et leur complexité croissantes par rapport aux années précédentes. Parmi les projets fréquemment menés en cours d’éducation musicale, on trouve :
- Les projets d’interprétation collective : préparation d’un répertoire varié pour un concert de fin d’année, participation à des rencontres chorales inter-établissements ou à des festivals académiques,
- Les compositions musicales originales : composition de chansons, création de bandes sonores pour des courts-métrages, arrangements personnalisés d’œuvres existantes,
- Les projets pluridisciplinaires : spectacles associant musique, théâtre et danse, souvent en collaboration avec les professeurs d’autres disciplines,
- Les projets numériques : production de podcasts musicaux, montage audio-vidéo, utilisation de logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur),
- Les projets de médiation culturelle : présentation d’œuvres à d’autres classes, organisation d’expositions sonores, préparation de guides d’écoute.
Ces projets s’étalent généralement sur plusieurs semaines, voire sur un trimestre entier. Ils impliquent un travail collaboratif important, développant ainsi les compétences sociales des élèves : écoute mutuelle, respect des propositions d’autrui, partage des responsabilités, résolution collective des problèmes rencontrés.
D’après une enquête du Conseil Supérieur des Programmes réalisée en 2023, « 87% des élèves de 3ème déclarent que les projets musicaux collectifs leur ont permis de développer leur confiance en eux et leur capacité à travailler en équipe. »
L’évaluation en éducation musicale
L’évaluation dans cette matière présente certaines spécificités par rapport aux autres disciplines. Elle s’attache à valoriser les progrès individuels tout en tenant compte de la dimension collective des apprentissages. Les modalités d’évaluation sont variées et complémentaires :
- Évaluation des compétences musicales : maîtrise technique, justesse, précision rythmique, expressivité, capacité à s’intégrer dans un ensemble,
- Évaluation des connaissances et ressources culturelles : reconnaissance d’œuvres, contextualisation historique et géographique, compréhension des notions musicales,
- Évaluation des compétences d’analyse : capacité à décrire une œuvre, à utiliser un vocabulaire spécifique, à argumenter un jugement esthétique,
- Évaluation de la créativité : originalité des propositions, pertinence des choix artistiques, capacité à explorer et à expérimenter.
Les professeurs de musique privilégient souvent l’évaluation par compétences, en utilisant des grilles critériées qui permettent aux élèves de situer précisément leurs acquis et leurs marges de progression. Cette approche s’inscrit dans la logique du socle commun de connaissances et de compétences.
En 3ème, une attention particulière est portée à la préparation du brevet des collèges. L’éducation sonore contribue à deux épreuves : l’épreuve orale et celle d’histoire des arts :
- Les élèves peuvent choisir de présenter un projet sonore réalisé en classe, ce qui nécessite une préparation spécifique (structuration du discours, contextualisation de l’œuvre, analyse des choix interprétatifs),
- L’épreuve d’histoire des arts : les connaissances acquises peuvent être mobilisées pour analyser des œuvres artistiques.
Les enseignants veillent à proposer des situations d’évaluation variées, permettant à chaque élève de valoriser ses points forts tout en progressant dans ses domaines de fragilité. L’autoévaluation et l’évaluation par les pairs sont également encouragées, afin de développer la capacité des élèves à porter un regard critique constructif sur leur travail et celui des autres.
Un accompagnement personnalisé peut faire toute la différence dans l’expérience d’apprentissage harmonique et rythmique d’un élève de 3ème, en transformant une matière parfois intimidante en une passion durable.
Que ce soit pour consolider les bases, préparer une orientation professionnelle ou simplement prendre plaisir à approfondir ses connaissances, Superprof propose des solutions adaptées à chaque besoin.
Ainsi des professeurs particuliers peuvent vous aider à peaufiner vos connaissances musicales et à progresser.
Et si vous preniez des cours à domicile pour réviser le programme de l’EMI en 3ème ?
L’éducation à la musique au collège représente une formidable opportunité pour les élèves de renforcer leur sensibilité artistique et leurs connaissances musicale.
Grâce à une approche mêlant technique vocale, instrumentale, analyse et création, chaque élève peut exprimer son potentiel. Les projets réalisés tout au long de cette période favorisent la confiance en soi et la collaboration.
Cette formation constitue une base précieuse pour toute poursuite musicale au lycée (et pourquoi pas l’université) ou en dehors du cadre scolaire. Entre autres, c’est le premier socle de connaissances pour ceux qui se destinent aux métiers de la musicologie.
Et vous, avez-vous un instrument de prédilection ? 🥁